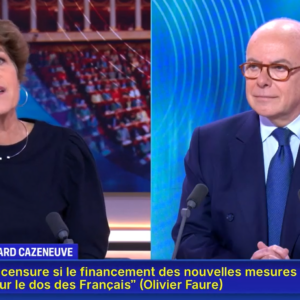La lutte contre les violences faites aux femmes a été érigée en grande cause du quinquennat d’Emmanuel Macron, une première fois en 2017, puis lors de sa réélection en 2022. Mais huit ans après le mouvement MeToo, force est de constater que la reconnaissance pleine et entière de ces violences par notre système judiciaire n’a toujours pas suivi.
Certes, ces dernières années, la France a adopté des politiques ambitieuses pour faire progresser les droits des femmes. L’inscription de l’IVG dans la Constitution a constitué une avancée historique, d’autant plus précieuse dans un contexte international marqué par la montée des mouvements conservateurs et masculinistes. Mais comme trop souvent, ces victoires restent symboliques tant qu’elles ne sont pas accompagnées des moyens nécessaires à leur pleine mise en œuvre.
Dans les universités, les boîtes de nuit, les salles de sport, les lieux de travail, dans l’espace public ou privé, 230 000 femmes continuent, chaque année, d’être victimes de viols, de tentatives de viol et/ou d’agressions sexuelles. Et lorsqu’elles osent dénoncer leurs agresseurs, elles se heurtent à un système qui ne les entend pas, ne les soutient pas, ne les protège pas.
Aujourd’hui, des affaires « hors norme » mettent en lumière les failles profondes de notre système judiciaire. L’affaire des viols de Mazan : une victime face à plus de 50 agresseurs identifiés. L’affaire Le Scouarnec : près de 300 viols et agressions sexuelles. L’affaire French Bukkake : 42 victimes, 17 hommes mis en examen pour proxénétisme aggravé et traite d’êtres humains.
Dans chacune de ces affaires d’une gravité extrême, malgré le nombre de mis en cause, malgré le nombre de victimes, malgré l’horreur des faits, la justice se contente d’un renvoi devant une cour criminelle départementale faisant fi des circonstances aggravantes. Ces juridictions, créées pour désengorger les cours d’assises, ne comptent que des magistrats professionnels. Exit le regard citoyen des jurys populaires, alors même que notre pays a toujours jugé les crimes les plus graves – meurtres, viols, vols à main armée – devant les cours d’assises. Pourquoi alors, relègue-t-on aujourd’hui les affaires de viol aux cours criminelles ? Ces crimes ne méritent ils pas l’attention de la société ?
Nous, députées et députés socialistes, ne nous contenterons jamais d’une justice au rabais. Depuis le mouvement MeToo, le nombre de plaintes n’a cessé d’augmenter.
Mais, tandis qu’un viol ou une tentative de viol a lieu toutes les 6 minutes, seulement 0,6% de ces crimes auraient donné lieu à une condamnation en 2020. Un chiffre dérisoire, témoignant de l’impunité dont jouissent les agresseurs dans notre pays.
Le parcours judiciaire des victimes doit être amélioré, avant, pendant et après le dépôt de plainte. Parce qu’il est inacceptable que 86 % des plaintes pour violences sexuelles et 94 % des plaintes pour viol soient écartées avant même d’être examinées par la justice.
Combien de ces classements sans suite auraient pu être évités si les forces de l’ordre avaient les moyens de mener des enquêtes dignes de ce nom ? Si la justice était capable de traiter ces affaires avec la rigueur et l’humanité qu’elles exigent ?
Nous demandons des moyens pour conduire des enquêtes approfondies, collecter les preuves avec rigueur, déployer des brigades spécialisées. Des moyens aussi pour la justice : nous ne pouvons plus tolérer cette disqualification des violences sexuelles dont les femmes sont les principales victimes. La création de cours d’assises spéciales pour juger ces procès hors normes devient une urgence absolue, tout comme la formation systématique et renforcée des magistrats aux violences sexistes et sexuelles.
La honte a changé de camp.
Il est temps que la justice suive.